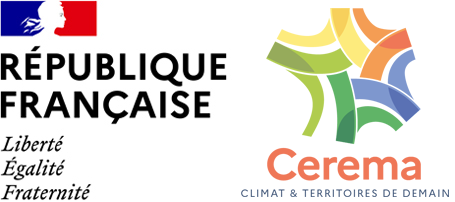Réseau viaire, congestion, accidentologie
Qualité des réseaux
Une bonne accessibilité en véhicule motorisé se caractérise par la présence de voies correctement dimensionnées et aménagées, des itinéraires directs, et par la présence de lieux de stationnement de capacité suffisante à proximité des emplois et des services.
Pour qualifier cette accessibilité, les analyses pouvant être réalisées sont les suivantes :
- hiérarchie du réseau viaire et niveau de service : qualité du réseau de voirie et niveau de service, y compris viabilité hivernale ;
- identification des axes structurants et flux routiers (trafic journalier VL/PL (véhicules légers/poids lourds, 2RM (2 roues motorisés) ;
La qualité du réseau viaire et du service est importante non seulement pour la circulation des véhicules particuliers et des poids lourds, mais influe également sur la qualité de service des offres de transports collectifs routiers : autocars interurbains, transport à la demande, transports scolaires, et également des offres de transports solidaires et de modes partagés (notamment covoiturage).
Congestion
Les territoires ruraux ne rencontrent généralement pas les mêmes difficultés que les agglomérations au regard des difficultés de circulations, mais l’accès aux pôles et certaines liaisons transversales structurantes peuvent donner lieu à des congestions aux heures de pointe. Des reports de trafic de transit peuvent également être générés vers des axes secondaires. Ces difficultés doivent être identifiées dans le cadre du diagnostic, à partir des dires d’acteurs, et d’une analyse du trafic à partir des données des gestionnaires de réseau (conseil départemental notamment).
A l’échelle des communes, les centres-bourgs, souvent contraints, peuvent être amenés à accueillir une circulation dense. Les plans de circulation et des aménagements spécifiques (zones 30, zones bleues, zones de rencontre, espaces piétonniers…) peuvent permettre d’améliorer à la fois les conditions de circulation et de stationnement, contribuant à la redynamisation des commerces, des services et des fonctions résidentielles.
Accidentologie
Les territoires en zones peu denses sont parfois peu sensibilisés à leur accidentalité c'est-à-dire aux données et statistiques des accidents qui s'y produisent. Cela peut venir du fait de la rareté des données, ou encore que les accidents y sont quantitativement moins importants, en valeur absolue, que dans les zones denses. Pour autant ils peuvent être soumis à des problématiques qui leur sont propres, telle que celle liée à un réseau viaire qui est moins hiérarchisé qu'en milieu urbain ou périurbain.
Pour les collectivités EPCI ayant accès à TRAXY (convention passée avec l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, ONISR), des rapports rapides sur les bilans locaux d'accidentalité sont disponibles à l'échelle des EPCI et des communes sous forme de chiffres, de tableaux et de graphiques. Les chiffres de référence du département d'appartenance sont également disponibles.
Pour les collectivité EPCI n'ayant pas accès à TRAXY, des outils et données sont disponibles sur le site de l'ONISR (https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/outils-statistiques), en libre accès et exploitables, notamment à l'échelle de l'EPCI : accidents par type, par mode et localisation sur une carte. Pour ces collectivités, le CEREMA peut générer à la demande les rapports rapides de bilans locaux d'accidentalité disponibles sous TRAXY.
Enfin, dans tous les cas, le CEREMA peut produire des analyses complémentaires à ces bilans locaux d'accidentalité, en fonction des enjeux locaux observés, dans le cadre d'une prestation payante.